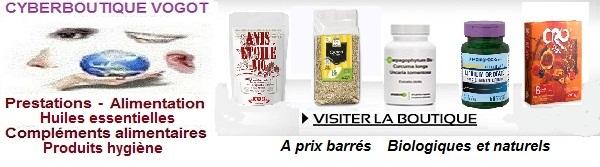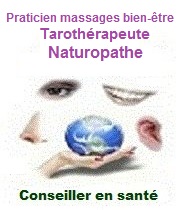Retracer le passé d’un patient est complexe. Ce dernier doit expliquer au praticien ses symptômes et ses comportements. Influencés par les normes culturelles locales régissant ses schémas fonctionnels et inquiets quant à la confidentialité des renseignements fournis, certains patients peuvent être mal à l’aise au moment d’évoquer ces sujets délicats.
Vous devez rapidement gagner la confiance du patient et l’assurer que l’entretien est confidentiel pour reconstituer l’histoire précise de la maladie dans le court laps de temps qui vous est imparti.
Besoins du patient
Cette partie vous permettra :
- d’identifier les différents besoins d’un patient consultant pour une pathologie notamment ses attentes concernant le cadre de guérison
- de tenir compte de la diversité des besoins, selon le sexe ou l’âge du patient.
L’anamnèse et l’examen physique du patient doivent permettre :
- de poser un état général, précis et efficace de la pathologie en cause,
- d’évaluer les risques (de transmission ou d’acquisition) de la maladie,
- de déterminer si d’autres risques peuvent créer des maladies de transfert.
Besoins élémentaires du patient
L’inquiétude ou la gêne sont fréquents chez le patient. Il sont donc importants dans le cadre de prise en charge et le praticien devra le mettre à l’aise.
Prise en charge
Confidentialité et respect de la vie privée sont deux maîtres mots. Il est important d’interroger le patient à l’abri des regards et des oreilles indiscrètes. Il est tout aussi important d’expliquer au patient que vous mettez tout en œuvre pour respecter la confidentialité des informations données en consultation.
Praticien de santé
Le plus important peut-être pour un patient, c’est de sentir que le praticien le comprend, le respecte et est à l’écoute. Pour ce faire, il faut établir une relation de confiance avec le patient et se garder de tout jugement.
Développer la relation praticien-patient
Un bon sens de la communication est indispensable pour créer une relation avec le patient. Cette capacité de communication englobe :
- la communication verbale : la manière de parler au patient et de lui poser des questions ;
- la communication non verbale : la manière de se comporter face au patient.
- Vous devez avant tout accueillir le patient de manière raisonnablement amicale et vous présenter.
- Souriez et parlez d’un ton amical.
- Présentez-vous.
- Adressez-vous au patient par son nom.
- Proposez-lui de s’asseoir.
- Ne commencez l’entretien que lorsque vous êtes dans un lieu tranquille et protégé.
- Regardez le patient droit dans les yeux, si les conventions culturelles le permettent.
- Montrez-vous respectueux et compréhensif.
La clé d’une communication non verbale efficace tient en une phrase : traiter chaque patient avec respect et lui accorder toute votre attention :
- Regardez le patient dans les yeux. Là où les conventions culturelles le permettent, échanger des regards avec le patient lui signifie votre intérêt. Une mine d’informations est transmise par la communication non verbale, notamment les expressions du visage et le mouvement des yeux. Observez et écoutez ; intéressez-vous autant aux émotions qu’aux faits.
- Écoutez attentivement ce que raconte le patient. Prêter une oreille attentive est le signe pour le patient que le praticien est véritablement à l’écoute et que ses préoccupations sont entendues. La capacité d’écoute est une qualité qui s’acquiert avec la pratique. Pour montrer que vous êtes réceptif, penchez-vous légèrement vers le patient. Acquiescez ou dites quelques mots de temps à autre pour l’encourager. Ne montrez aucun signe d’impatience et évitez d’écrire pendant le récit du patient. Évitez de l’interrompre à moins de devoir éclaircir un point.
- Utilisez la technique du miroir. Si le patient est assis, asseyez-vous ; s’il se met debout, levez-vous. Le recours à cette technique non verbale aide le patient à se sentir plus à l’aise. Elle vous place sur un pied d’égalité avec le patient. Regarder le patient littéralement de haut peut être ressenti comme menaçant.
- Restez à côté du patient. Réduisez la distance autant que les conventions culturelles le permettent. Un bureau ou une table créent une barrière physique entre vous et votre patient. Nous ne sommes pas dans un cabinet médical austère et froid. Si possible, tenez-vous ou asseyez-vous à côté de lui. Très simples, ces quatre techniques non verbales peuvent tout changer dans le rapport de confiance ou de méfiance que vous établissez avec votre patient. Sommes-nous vraiment sûrs à 100 % de projeter une attitude positive à tous nos patients ?
Compétences verbales pour l’anamnèse
Au-delà des techniques de communication verbale que nous avons passées en revue, il est intéressant d’étudier les méthodes d’entretien à privilégier pour l’anamnèse, ainsi que les différentes techniques de communication verbale.
Poser des questions
Vous devez obtenir de chaque patient des renseignements importants sur son état de santé : cela englobe non seulement ses symptômes et ses antécédents médicaux, mais aussi son passé (parents, grossesse de la mère, vie intra-utérine, petite enfance, enfance, adolescence, éducation, expériences adultes, sexualité...).
Je vous recommande :
- de vous garder de tout jugement moral dans la formulation de vos questions (utiliser le conditionnel) ;
- d' éviter le jargon médical et choisir des termes compréhensibles, adaptés au patient ;
- de demander au patient l’autorisation de lui poser des questions personnelles.
Questions ouvertes et fermées
Deux types de questions peuvent être posées au patient : questions ouvertes et questions fermées.
Une question ouverte permet au patient de donner une réponse détaillée ou d’enchaîner librement sur un autre sujet.
- « De quoi souffrez-vous ? »
- « Quels types de médicaments prenez-vous en ce moment ? »
- « Qu’est-ce qui vous amène aujourd’hui ? »
Une question fermée invite le patient à répondre par un seul mot ou une courte phrase, souvent oui ou non.
- « La douleur est-elle aigüe ? »
- « Avez-vous un retard de règles ? »
- « Avez-vous un partenaire régulier ? »
- « Quel âge avez-vous ? »
- « Avez-vous angoisses ? »
Les questions ouvertes incitent le patient à s’exprimer avec ses propres mots et à raconter tout ce qui lui semble important. Ainsi, on peut obtenir beaucoup plus d’informations en posant une seule question ouverte qu’en utilisant plusieurs questions fermées. Par ailleurs, la sexualité (thème que nous allons développer plus bas), étant un sujet difficile à aborder, les questions ouvertes permettent au patient de garder une certaine maîtrise du discours et de se sentir plus à l’aise.
Les questions fermées, elles, invitent le patient à répondre précisément à la demande formulée par le praticien. Ce type de question est utile pour préciser certaines informations. On peut, si nécessaire, compléter les réponses aux questions ouvertes par des questions fermées.
Pour illustrer la différence entre questions ouvertes et questions fermées, comparez les deux exemples donnés ci-après. Observez la quantité d’informations recueillies pour chaque type de question.
Le praticien obtient beaucoup plus d’informations, par le simple recours à des questions ouvertes : « Que pouvez-vous me dire sur ces douleurs ? » et « Y a-t-il autre chose qui vous gêne ? ». Vous conviendrez peut-être également que le patient semble plus à l’aise ; il a moins l’air de subir l’entretien.
J'insiste sur l’importance de poser plusieurs fois la deuxième question : « Y a-t-il autre chose ? ». En effet, certains patients sont tellement embarrassés à l’idée de parler de leurs pathologies qu’ils décrivent d’abord d’autres symptômes sans rapport, tels qu’un mal de tête, avant d’être suffisamment détendus pour passer aux vrais symptômes. Donner au patient la possibilité de s’étendre sur ses différents motifs de consultation permet souvent de glaner des informations utiles.
Une fois certain d’avoir obtenu le tableau complet du problème vu par le patient, vous pouvez poser des questions fermées pour demander des détails précis.
Techniques spécifiques de communication verbale
Parallèlement à une communication non verbale positive et à un interrogatoire adapté et respectueux.
- Patiente : J’ai mal au ventre.
- Praticien : On va regarder ça. Où avez-vous mal ?
- Patiente : Ici.
- Praticien : La douleur est-elle constante ?
- Patiente : Non.
- Praticien : Est-ce que c’est sensible ici ?
- Patiente : Oui.
- Praticien : Quand les douleurs ont-elles commencé ?
- Patiente : La semaine dernière.
- Patiente : J’ai mal au ventre.
- Praticien : On va regarder ça. Que pouvez-vous me dire sur ces douleurs ?
- Patiente : Eh bien, j’ai commencé à avoir mal la semaine dernière. Au début, c’était juste sensible en bas, mais parfois, la douleur est très forte. Surtout quand je m’assieds ou que je me lève. C’est très différent selon les positions.
- Praticien : Y a-t-il autre chose qui vous gêne ?
- Patiente : En fait, oui, un liquide étrange, différent de d’habitude. Ça ne fait pas mal, mais c’est gênant.
Anamnèse et examen physique
Certaines techniques et compétences spécifiques peuvent être extrêmement utiles pour interroger une personne. Elles vous permettront à la fois de soutenir votre patient, et de rassembler efficacement les renseignements dont vous avez besoin.
Six techniques sont à votre disposition :
- facilitation,
- entretien directif,
- résumé et vérification,
- empathie,
- légitimation/réconfort,
- affirmation d’un partenariat/contrat de soins.
1. Facilitation
Par facilitation, on entend l’ensemble des mots, sons et gestes qui invitent le patient à poursuivre son récit. Acquiescer ou lever les sourcils sont deux exemples de facilitation non verbale. Le but est d’encourager discrètement le patient à poursuivre. Voici un exemple de facilitation verbale.
- Patiente : Je ne suis pas sûre… c’est gênant.
- Praticien : C’est normal, je vous écoute.
- Patiente : Voilà, c’est que...
- Praticien : Oui ?
- Patiente : J’ai une plaie…
2. Entretien directif
Cette technique est utile lorsque le patient est confus et ne sait pas par où commencer, ou lorsqu’il ne sait pas ce qu’il est important de dire. L’entretien directif aide le sujet à structurer ses idées et à donner les renseignements requis sous forme de séquence.
Patiente : Je ne sais pas, ça fait trois semaines. Qu’est-ce que je vais dire à mon mari ? Est-ce que tout le monde va savoir ? Je veux dire, ça se guérit, n’est-ce pas ?
- Praticien : Essayons de voir quel est le problème. Commençons par régler ça, puis nous verrons comment en parler à votre mari.
L’entretien directif permet au patient d’exprimer ses craintes et inquiétudes plus facilement.
3. Résumé et vérification
Le fait de résumer et de vérifier les propos du patient vous permet de vous assurer que vous l’avez bien compris. Il peut lui-même corriger tout malentendu. L’idée est de reformuler les propos du patient et de lui demander si le résumé est correct. Employez cette technique quand le patient a mentionné un certain nombre de points que vous voulez confirmer.
- Praticien : (Résumé) Vous vous inquiétez de ce qu’il faut dire à votre mari et vous êtes donc très embarrassée par cette infection. Vous voulez savoir si on peut la guérir. (Vérification) C’est bien ça ?
- Patiente : Oui, c’est ça. Qu’est-ce que j’ai ?
4. Empathie
C’est peut-être l’attitude communicante la plus importante lorsque l’on est confronté aux émotions d’un patient. Si vous constatez un sentiment d’anxiété ou de tension chez le patient, vous pouvez exprimer votre empathie en commentant l’émotion que vous avez observée. Vous montrez ainsi au patient qu’il a le droit d’exprimer ses craintes, et développez une communication plus ouverte avec lui. Comme pour les techniques de facilitation, vous encouragez alors le patient à en dire plus.
- Praticien : (Doucement) Je vois que vous êtes très inquiète.
- Patiente : Oui, cela fait plus d’une semaine que ça me gêne. Je suis morte d’inquiétude.
5. Légitimation/réconfort
Il est utile de réconforter le patient pour le rassurer sur le fait que ses émotions sont légitimes et que l’on peut régler son problème. Avec vos mots ou vos gestes, vous montrez au patient que son anxiété peut disparaître.
- Praticien : Je comprends que vos symptômes vous inquiètent. Dès que je pourrai confirmer votre pathologie, nous commencerons un traitement et vous devriez vous sentir mieux.
- Patiente : Ça me rassure. Que voulez-vous savoir ?
6. Affirmation d’un partenariat
L’affirmation d’un partenariat confirme l’engagement du praticien d’aider le patient. Ce contrat de soins peut être passé avec le praticien , à titre personnel, comme dans l’exemple ci-dessous.
- Praticien : Vous avez bien fait de venir consulter. Je voudrais m’assurer que vous êtes au courant de tout ce qu’il faut savoir pour prévenir une nouvelle infection. Nous évoquerons aussi la meilleure façon de parler à votre mari.
- Patiente : Oh merci ! Je ne veux pas que ça se reproduise.
La plupart des professionnels de santé expérimentés emploient de temps en temps certaines de ces techniques d’entretien. Pour réussir l’interrogatoire d’un patient, il faut recourir la plupart du temps aux six techniques proposées.
Anamnèse et examen physique du patient
Rassembler les informations
Il vous sera utile d’améliorer vos compétences d’entretien, car une bonne anamnèse est la clé d’un diagnostic précis et rapide. Les renseignements communiqués par le patient sont le point de départ pour comprendre ses comportements et trouver quelle a été la racine du mal.
Tout d’abord, il est utile de préciser les raisons de l’anamnèse. L’interrogatoire du patient est important pour :
- évaluer les causes de la maladie ;
- déterminer les conséquences de la maladie.
Voici les informations que vous devez obtenir à peu près dans cet ordre.
- Renseignements généraux sur le patient
- Âge
- Nombre d’enfants
- Adresse
- Emploi
- Maladie actuelle du patient
- Antécédents médicaux du patient
Pour chaque patiente, procédez à une évaluation des risques.
Les questions doivent être adaptées en fonction du contexte social et comportemental local.
Communication verbale et non verbale pour l’anamnèse
Voici un exemple d’entretien où le praticien emploie des techniques verbales et non verbales pour interroger le patient. Vous comprendrez le type de technique employé.
Vous pouvez également évoquer tout autre chose que son médecin généraliste aurait pu dire ou faire pour ce patient.
Questions et réponses. Observations
- Praticien: Bonjour, asseyez-vous. Je m’appelle Monsieur (prénom et nom), je suis praticien de santé (vous pouvez décrire votre parcours professionnel). Comment vous appelez-vous ?
Présentation amicale et question ouverte du patient X.
- Praticien: Que puis-je faire pour vous aider ? (Question ouverte, facilitation)
- Patient X: Eh bien, je me suis luxé le bras hier en essayant de me débarrasser d’un vieux tronc. C’est assez douloureux.
- Praticien : Oh, voyons si cela à l'air grave, vous avez bien fait de venir pour traiter votre douleur. Je peux regarder et passer une crème ou une pommade sur votre bras si vous voulez. Vous êtes venu de loin pour cette consultation ? (Réconfort)
- Patient X : Oh, je vis à moins de dix kilomètres d’ici, près de (nom du village).
- Praticien : Bien. (Application de la crème ou de la pommade.) Y a-t-il autre chose que vous souhaitez faire examiner ? Question ouverte, facilitation
- Patient X : En fait... oui (rire nerveux).
Anamnèse et examen physique du patient
- Praticien : Ça vous gêne peut-être d’en parler... Empathie
- Patient X : Oui, ça me gêne... vous voyez, c’est au niveau (se penche et murmure)... de mon pénis.
- Praticien : Oui ? Facilitation
- Patient X : Eh bien (hésitation), il y a... (hésitation) comme une plaie.
- Praticien : Et cette plaie vous inquiète ? Empathie/vérification
- Patient X : Oui. En fait, ça ne fait pas mal, mais ce n’est pas beau à voir. Ça m’inquiète un peu. Enfin, une de mes petites amies m’a dit que c’était… mauvais et refuse de me voir… Ça vient peut-être d’une fille que j’ai rencontrée dans un bar ou même d’une de mes petites amies.
- Praticien : Que pouvez-vous me dire sur cette plaie ? Question ouverte, entretien directif
- Patient X : Que dire ? Ça ne fait pas mal… (haussement d’épaules)
- Praticien : Depuis combien de temps avez-vous cette plaie ? Question fermée, pour obtenir une information précise
- Patient X : Oh, un mois environ, je suppose. Mon oncle dit que je ne dois pas m’inquiéter, mais je pense que ça vient d’une femme… si je trouve laquelle…
- Praticien : Monsieur X, il est clair que le fait que la plaie se trouve à cet endroit vous angoisse, mais je pense que nous devons d’abord déterminer ce que c’est. Je pense que nous devons aussi discuter de ce que vous pouvez faire pour éviter que ça se reproduise.... Je vais d’abord devoir examiner cette plaie... (Empathie, entretien directif).
- Patient X : (Regard surpris)
- Praticien : Je sais que ça peut être gênant, mais je dois vous examiner pour savoir quel est le problème. Vous êtes d’accord ? (Empathie, réconfort, partenariat).
- Patient X : Oui, enfin, je suppose (à contrecœur).
- Praticien : Je dois être sûr avant de vous proposer un traitement.
- Patient X : Ça va aller, n’est-ce pas ?
- Praticien : Oh oui, et avec votre aide, je peux vous traiter et vous guérir. Je vous dirai tout ce qu’il faut savoir et vous aiderai à décider ce que vous allez faire. Ça vous va ? (Réconfort, partenariat).
- Patient X : Oui. (Soulagement)
Examen physique
L’examen physique sert à confirmer la présence des symptômes décrits par le patient. Cette partie explique la conduite à tenir lors de l’examen d’un patient et d’une patiente. Dans certains pays, il est habituel que les patientes soient examinées par des femmes, et les patients par des hommes. La situation varie selon l’emplacement géographique. L’examen des parties intimes d’un patient exige du praticien tact, sensibilité et respect. Les patients peuvent être gênés ou mal à l’aise.
Il existe des méthodes pour aider le patient à comprendre l’importance de l’examen physique et à surmonter sa gêne.
Veuillez noter que cette partie ne traite que de l’examen et ne couvre pas toutes les maladies sexuelles, comme la gale ou la phtiriase du pubis, que vous êtes normalement amené à traiter dans le cadre habituel de vos fonctions.
Veuillez garder à l’esprit que :
- Une bonne anamnèse passe par un interrogatoire complet du patient et l’examen physique de ses parties génitales ;
- Je recommande le port de gants, en particulier pour inspecter des muqueuses, dont les parties génitales, la bouche et l’anus.
Cette partie vous aidera à :
- vous comporter de façon professionnelle avant et pendant l’examen physique du patient ;
- rassurer les patients qui refusent de se faire examiner et gagner leur confiance et leur coopération ;
- réaliser un examen efficace, que le patient soit un homme ou une femme.
Pour l’examen des parties génitales, vous devez rester professionnel devant la timidité, voire le refus, de certains patients. Vous devez :
- garantir le respect de l’intimité ;
- expliquer ce que vous allez faire et pourquoi l’examen est important ;
- demander au patient l’autorisation de l’examiner ;
- rester calme et éviter de vous presser pendant l’examen, même si vous avez peu de temps ;
- aborder l’examen avec assurance, mais en restant à l’écoute des besoins du patient.
Pour la plupart des syndromes, l’examen est une étape importante de l'anamnèse. Cela dit, il ne faut jamais forcer le patient à subir un examen physique. S’il refuse, vous devez le rassurer et lui expliquer la situation jusqu’à ce qu’il vous accorde sa confiance.