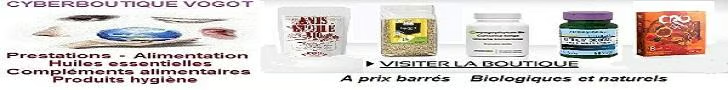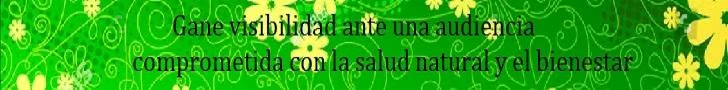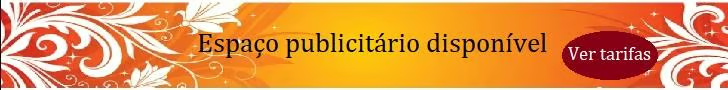Neuropathie périphérique.
Une neuropathie correspond à une lésion ou à un dysfonctionnement du système nerveux périphérique. Les neuropathies périphériques peuvent concerner un seul nerf, comme dans le cas du syndrome du canal carpien ou de la sciatique. On parle alors de mononévrite.
Toutefois, dans le langage courant, le terme « neuropathie périphérique » désigne le plus souvent une atteinte de l’ensemble des nerfs, appelée polyneuropathie. Les symptômes apparaissent généralement d’abord aux extrémités, aux pieds et aux mains, puis remontent progressivement le long des jambes et des bras.
Système nerveux périphérique.
Le terme de neuropathie est habituellement employé pour désigner la neuropathie périphérique, c’est‑à‑dire l’atteinte des nerfs issus des racines de la moelle épinière et parcourant l’ensemble du corps. Le système nerveux périphérique s’oppose au système nerveux central, qui comprend les neurones situés dans le cerveau et la moelle épinière. Il existe un grand nombre de neuropathies, pouvant toucher un ou plusieurs nerfs.
Le système nerveux périphérique commence à la sortie de la moelle épinière : les racines donnent naissance à plusieurs nerfs qui descendent dans les bras et les jambes et desservent les muscles. Les neuropathies périphériques se situent donc entre la moelle épinière et le muscle.
Rôle des terminaisons nerveuses.
Les terminaisons nerveuses sont les extrémités des nerfs présentes dans la peau, mais aussi dans les viscères et les muscles. Leur rôle est d’enregistrer différentes sensations : le chaud, le froid, la douleur. Lorsqu’elles captent un message, elles le transmettent au cerveau via les fibres nerveuses et la moelle épinière, comme lors d’une brûlure. Le cerveau adopte alors la réponse adéquate, par exemple retirer la main de la source de chaleur.
Catégories de terminaisons nerveuses.
Sans trop entrer dans les détails, les terminaisons nerveuses se divisent en deux grandes catégories.
- Les terminaisons libres : nociceptives (douleur) et thermoréceptrices (chaud et froid).
- Les terminaisons encapsulées : tactiles (corpuscules de Meissner), pression et vibrations (corpuscules de Pacini).
Plusieurs types de neuropathies existent. Dans cet article, nous allons nous concentrer sur la neuropathie inflammatoire.
La neuropathie inflammatoire.
Certaines neuropathies sont dites inflammatoires, car elles sont liées à des maladies générales comme les vascularites. On peut également citer la polyradiculonévrite inflammatoire démyélinisante chronique (PIDC), ainsi que sa variante, le syndrome de Lewis‑Sumner. Il s’agit d’une maladie auto‑immune dont les symptômes se rapprochent de ceux du syndrome de Guillain‑Barré, une forme aiguë évoluant en moins de deux mois et pouvant nécessiter une réanimation en cas d’atteinte des nerfs respiratoires.
Dans la PIDC, ce ne sont pas les axones qui sont touchés, mais les fibres myélinisées. On parle alors d’une atteinte des fibres myélinisées, un terme employé par la médecine allopathique.
Causes d'une neuropathie.
Les causes d’une neuropathie sont extrêmement nombreuses, et il en existe plusieurs centaines.
Parmi elles, on peut citer :
- Les causes métaboliques : principalement le diabète mal ou non contrôlé, l’insuffisance rénale ou encore la dénutrition liée à une consommation excessive d’alcool.
- Les causes héréditaires : elles sont fréquentes en France et doivent être systématiquement envisagées. La principale maladie héréditaire responsable de neuropathie périphérique est la maladie de Charcot‑Marie‑Tooth.
- Les causes toxiques : certains médicaments, comme la Vincristine utilisée dans certaines chimiothérapies, peuvent provoquer des neuropathies périphériques. La liste des médicaments concernés est malheureusement très longue.
- Les maladies systémiques : par exemple les vascularites.
Environ 50 % des polyneuropathies axonales chroniques, les plus fréquentes, restent inexpliquées, même après un suivi thérapeutique de cinq ans. Toutefois, ces neuropathies sans cause identifiée évoluent en général de manière bénigne.
Neuropathie axonale.
L’axone est une fibre nerveuse. L’atteinte de l’axone concerne l’immense majorité des polyneuropathies périphériques. Un nerf est constitué de fibres nerveuses qui sont soit des axones, soit des axones entourés d’une gaine de myéline, appelées fibres myélinisées. Une neuropathie peut donc atteindre l’axone ou la myéline.
Symptômes.
- Paralysie progressive d’un ou de plusieurs muscles.
- Fourmillements, picotements, brûlures : ensemble de symptômes sensitifs appelés paresthésies.
- Diminution des réflexes.
Paralysie : causes, AVC, durée, que faire.
La paralysie peut durer quelques minutes, mais elle peut aussi être irréversible. Ses causes sont multiples : accident vasculaire cérébral (AVC), lésion, sclérose en plaques, maladie de Charcot. Il est essentiel de connaître les signes d’alerte et les gestes à adopter en urgence. Les symptômes, le diagnostic et les traitements doivent être envisagés rapidement.
Spécialistes à consulter.
Le neurologue ou le rhumatologue sont les deux spécialistes allopathiques les plus concernés par les neuropathies périphériques. Toutefois, l’exploration d’une polyneuropathie relève souvent d’un centre spécialisé. Il en existe une vingtaine en France, répartis sur tout le territoire. Le recours à un naturopathe‑hygiéniste peut également être envisagé lorsque la médecine dite « traditionnelle » n’apporte plus de soulagement.
Diagnostic.
L’examen clinique doit être orienté vers la recherche d’une atteinte du système nerveux périphérique. La diminution ou l’abolition des réflexes en est le signe majeur. L’électroneuromyogramme (EMG) est une exploration qui permet d’étudier le fonctionnement des nerfs et des muscles.
Cet examen est systématique pour confirmer le diagnostic. Il est réalisé le plus souvent par un neurologue, mais aussi par un rhumatologue. Des examens biologiques complètent l’évaluation afin d’identifier la cause. Dans le cas d’une maladie héréditaire, comme la maladie de Charcot‑Marie‑Tooth, des tests génétiques sont réalisés.
Traitements.
Lorsqu’il s’agit d’une cause héréditaire, il n’existe actuellement pas de traitement médicamenteux. L’évolution est généralement bénigne et se limite le plus souvent à une gêne fonctionnelle.
En cas de cause métabolique, comme le diabète, il est nécessaire de traiter la cause. Il en va de même pour les maladies générales.
Pour une neuropathie inflammatoire, la prise en charge vise également la maladie sous‑jacente, même si la médecine allopathique peut parfois s’avérer insuffisante.
Lorsqu’une neuropathie est due à la Vincristine, la décision de poursuivre ou non le traitement se prend avec l’oncologue. Dans ce cas, le seul traitement reste l’arrêt du médicament, en accord avec le thérapeute référent.
La polyradiculonévrite inflammatoire démyélinisante chronique (PIDC) nécessite une prise en charge sur le long terme dans des centres spécialisés. Trois traitements sont actuellement proposés :
- Les corticostéroïdes.
- Les échanges plasmatiques (EP).
- Les immunoglobulines intraveineuses (Ig‑IV).
Par ailleurs, certains médicaments peuvent soulager les douleurs neuropathiques. Ils appartiennent à la classe des anti‑épileptiques et doivent être utilisés avec précaution en raison de leurs effets indésirables.
Neuropathie et naturopathie.
Comme nous l’avons vu, en médecine allopathique, après les diagnostics, une panoplie de médicaments plus ou moins efficaces est prescrite, accompagnée d’examens approfondis réalisés par des spécialistes. Cette réponse peut être satisfaisante dans certains cas, mais elle laisse parfois une impression d’inachevé. Une partie des personnes concernées se tourne alors vers les approches complémentaires, comme la naturopathie.
Il est important de rappeler que l’inflammation n’est pas une maladie, mais un état dans lequel se retrouve l’organisme. Pour atténuer la douleur, l’alimentation fait partie des outils privilégiés en naturopathie. C’est un moyen naturel et fondamental pour réduire l’inflammation. Tout naturopathe qui se respecte commencera, après anamnèse, par proposer une modification des habitudes alimentaires afin de transformer le « terrain ».
Changement de vision : qu'est-ce que l'inflammation.
L’inflammation n’est pas une maladie à proprement parler, mais un état. Elle est généralement activée par notre force vitale, ce pouvoir d’auto‑guérison qui répare l’organisme en mobilisant nos défenses (contre un virus, une bactérie) ou en éliminant nos déchets internes. Elle répond donc à une agression traumatique, infectieuse ou auto‑immune.
L’inflammation provoque des symptômes douloureux qui signalent sa présence. Elle devient problématique lorsqu’elle nuit davantage qu’elle ne répare. Dans ce cas, le corps s’emballe et se retrouve débordé, incapable de s’auto‑réparer efficacement.
Symptômes de l'inflammation.
- Douleur, souvent plus intense la nuit.
- Tuméfaction.
- Chaleur locale.
- Rougeur.
L’inflammation peut être cutanée ou sous‑cutanée, comme dans le cas d’un abcès. Elle est généralement confirmée par une prise de sang, sauf dans la fibromyalgie où les micro‑inflammations ne sont pas détectables. L’inflammation crée la maladie, et non l’inverse.
Inflammation et chronicité.
Dans certains cas, l’état inflammatoire persiste et dépasse ses fonctions de défense. Il devient alors pathologique, comme dans l’arthrite ou la goutte. Le système immunitaire, dépassé, laisse place à des pathologies plus lourdes telles que la polyarthrite rhumatoïde, la maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique, le lupus ou la fibromyalgie.
Naturopathie et inflammations.
La naturopathie intervient pour réduire l’état inflammatoire, soulager la douleur et améliorer la qualité de vie. Elle propose plusieurs méthodes visant à drainer l’organisme, faciliter l’élimination des déchets et assainir le terrain, afin de diminuer l’inflammation chronique.
L’inflammation résulte d’un encrassement des humeurs, c’est‑à‑dire des liquides dans lesquels baignent nos cellules. Drainer et éliminer ces déchets permet de réduire l’inflammation et de sortir l’organisme de cet état chronique.
L’alimentation, l’exercice physique, les plantes, la respiration et le massage sont autant d’outils utilisés par le naturopathe, en soutien et en complément d’un traitement allopathique si nécessaire. L’alimentation reste, à elle seule, un moyen essentiel et efficace de lutte contre l’inflammation.
Alimentation et état inflammatoire.
L’alimentation demande un travail important de digestion. Le pancréas est fortement sollicité, entraînant une suractivité du nerf vague. Cette situation favorise la congestion de l’organisme, qui produit alors une inflammation pouvant conduire à une maladie inflammatoire. Je vous invite à lire l’article « Du vague à l’âme ».
La stratégie consiste à distinguer deux catégories d’aliments :
- Les aliments anti‑inflammatoires, qui ne sollicitent pas excessivement le pancréas.
- Les aliments pro‑inflammatoires, qui favorisent l’état inflammatoire.
Aliments anti-inflammatoires.
Une alimentation anti‑inflammatoire est généralement biologique ou de qualité, sans glucose, modérée en protéines et riche en bons lipides. La cuisson doit être douce, à la vapeur ou au court‑bouillon.
Parmi les aliments à privilégier :
- Les légumes, en particulier les crucifères (choux, brocolis, choux de Bruxelles, navets, radis) et les légumes à feuilles comme les épinards.
- Les fruits, surtout les fruits rouges.
- Les oléagineux : noix, amandes, noisettes.
- Les légumes secs, sources de protéines végétales et de fibres.
- Le riz, à privilégier plutôt que les pâtes.
- Les farines de sarrasin, riz, seigle, châtaigne, maïs, petit épeautre.
- Les viandes blanches.
- Les poissons sauvages, en particulier les poissons gras riches en oméga‑3.
- Le citron, qui devient alcalin dans l’estomac.
- Les huiles d’olive, de coco, de colza, de tournesol, de noix.
- Le sirop d’agave en remplacement du sucre.
- Les eaux riches en bicarbonate : Vichy (St Yorre, Célestin), Badoit, Mont Roucoux, Vittel, Hépar.
- Les herbes et épices.
- Le thé vert et le chocolat noir.
Aliments pro-inflammatoires.
En parallèle, il est nécessaire de réduire, voire de supprimer, les aliments pro‑inflammatoires. Ils sollicitent trop le pancréas et aggravent l’état inflammatoire.
À diminuer significativement en cas de terrain inflammatoire, et à supprimer en cas de maladies inflammatoires :
- Les aliments acides : vinaigre de vin (sauf vinaigre de cidre), viandes rouges, ail et oignon en excès.
- Les produits laitiers, qui aggravent l’inflammation.
- Les farines raffinées (blé blanc) à remplacer par des farines complètes, de préférence sans gluten.
- Le sucre et toutes ses sources : pâtisseries, sucre blanc, complet, de canne, confitures, édulcorants, miel, ainsi que les produits industriels contenant du glucose.
- Le thé noir, le café et l’alcool.
Méthodes alternatives et remèdes naturels.
Plusieurs approches naturelles peuvent compléter l’alimentation pour soulager la douleur neuropathique.
- Curcuma. Grâce à la curcumine, il possède des propriétés anti‑inflammatoires et antioxydantes. Il peut être consommé dans l’alimentation ou appliqué en pâte sur les zones douloureuses.
- Massage. Il stimule la circulation sanguine et apporte l’oxygène nécessaire aux nerfs. Il peut être pratiqué en auto‑massage (Do‑In) ou par un professionnel.
- Acupression. Technique ancestrale agissant sur les méridiens, utile pour réduire la douleur nerveuse.
- Baies d’açai. Riches en antioxydants, elles réduisent l’inflammation, stimulent la circulation et aident à soulager la douleur.
- Arrêt du tabac. Le tabagisme réduit la circulation sanguine et favorise la neuropathie. L’arrêt améliore la santé nerveuse et générale.
- Réduction de l’alcool. L’alcool déshydrate et resserre les vaisseaux sanguins, limitant l’apport sanguin aux nerfs.
- Hydratation. Boire 8 à 10 verres d’eau par jour est essentiel pour maintenir l’équilibre hydrique et réduire la douleur neuropathique.
- Millepertuis. Plante aux propriétés anti‑inflammatoires et régulatrices du stress, disponible en compléments.
- Yoga. Améliore la circulation, réduit l’inflammation et favorise la détoxification.
- Perte de poids. Réduit le risque de neuropathie, améliore la circulation et diminue l’inflammation.
- Réflexologie plantaire. Méthode manuelle stimulant les zones réflexes des pieds, favorisant l’équilibre, la détente et l’auto‑guérison.
- Crème de capsaïcine. Issue du piment, elle réduit l’inflammation en occupant les récepteurs nerveux sensibles.
- Méditation. Diminue les hormones de stress, améliore la circulation et réduit l’inflammation.
Hijama ou cupping therapy.
Les troubles neurologiques regroupent les atteintes du système nerveux. Ils concernent le cerveau, la moelle épinière, les nerfs périphériques, la jonction neuro‑musculaire et les muscles. La hijama, ou thérapie par les ventouses, possède une action épuratrice et hormonale. C’est toutefois son action neurologique et son effet sur la douleur qui retiennent ici notre attention. La cupping therapy constitue en effet une solution naturelle pour soulager certaines affections neurologiques ou compléter leur traitement.
La hijama consiste à placer des ventouses en verre, en plastique ou en bambou sur des points précis du corps. La mise en place de la ventouse crée un vide qui soulève la peau. Dans le cas d’une hijama humide, un peu de sang est aspiré, alors que dans une hijama sèche, il ne l’est pas. Cette technique stimule le flux sanguin et favorise l’élimination des toxines des tissus.
Le système nerveux.
Le système nerveux gère les sensations, les mouvements musculaires et le fonctionnement des organes. Il peut toutefois dysfonctionner en raison du vieillissement, d’anomalies génétiques, de traumatismes, d’infections ou d’intoxications. Ces perturbations peuvent entraîner des maladies telles que l’épilepsie, les tremblements ou les neuropathies.
Le système nerveux se divise en deux parties :
- Le système nerveux central (SNC), composé de l’encéphale (cerveau, tronc cérébral, cervelet) et de la moelle épinière.
- Le système nerveux périphérique, constitué des nerfs et des ganglions nerveux. Les nerfs, sensitifs ou moteurs, relient le SNC aux organes (peau, muscles, viscères).
Les nerfs sensitifs détectent les informations périphériques (peau, muscles, tendons, articulations) et les transmettent au SNC. Les nerfs moteurs transmettent les commandes du SNC aux muscles. Le système nerveux reçoit, traite et émet des messages entre le corps et le cerveau. Les cellules nerveuses sécrètent des neurotransmetteurs, qui exercent une action excitatrice ou inhibitrice sur d’autres cellules nerveuses.
Mécanisme de la douleur.
Lors d’un traumatisme, comme un doigt coincé dans une porte, les récepteurs de la douleur sont stimulés. Les cellules endommagées libèrent des prostaglandines, présentes dans la plupart des tissus. Ces substances déclenchent les terminaisons nerveuses, qui transmettent le signal douloureux. Le signal électrique est transformé en message chimique pour atteindre le neurone suivant. La moelle épinière transporte ensuite ce message vers le cerveau, où il est perçu comme douleur.
Action de la ventouse.
La pose d’une ventouse peut court‑circuiter la transmission de la douleur vers le cerveau. Elle stimule certains neurones qui libèrent des enképhalines, substances inhibant le message douloureux, à la manière des analgésiques. Elle améliore également la circulation sanguine, régule la tension artérielle et stimule la sécrétion d’endorphines, hormones du bien‑être. Cela explique que certaines personnes ressentent une détente profonde, voire une envie de dormir, après une séance.
La hijama entraîne aussi une baisse des prostaglandines, impliquées dans les processus inflammatoires. Elle agit donc sur les substances responsables de la douleur. Au niveau des organes, elle exerce une action régulatrice sur les muscles lisses (foie, reins, intestins, cerveau, poumons), contrôlés par le système nerveux autonome. En posant des ventouses sur des points spécifiques, comme celui de l’estomac, il est possible d’agir directement sur l’organe correspondant.
En définitive, la hijama représente une alternative intéressante pour soulager les névralgies (sciatique, maux de tête, dorsalgies, cervicalgies, hémiplégies, paresthésies). Elle peut également aider à atténuer certains effets secondaires d’un accident vasculaire cérébral. Des études ont montré une amélioration de la force musculaire et de la réhabilitation post‑AVC, notamment pour l’aphasie et le hoquet séquellaire. D’autres recherches restent toutefois nécessaires pour confirmer pleinement ces indications.
Neuropathie et compléments alimentaires.
Jusqu’à présent, la grande majorité des industriels de l’agroalimentaire ont privilégié la recherche du moindre coût pour maximiser leurs profits. Cette logique, bien que légitime d’un point de vue économique, a eu des conséquences néfastes pour la santé publique. Plus d’un Français sur deux est aujourd’hui en surpoids ou obèse, malgré les innombrables initiatives et programmes nutrition‑santé qui se succèdent. Le bilan des régimes célèbres reste pauvre.
Pour bénéficier d’une alimentation de qualité, il faut accepter de payer un peu plus cher. À l’inverse, une alimentation médiocre coûte de plus en plus cher à la société, en contribuant à l’explosion des maladies chroniques non transmissibles (diabète, pathologies cardiovasculaires, cancers). Elle fragilise également les individus, comme l’a montré la relation entre obésité et Covid‑19.
Le surcoût lié à l’achat de produits de meilleure qualité peut être compensé par le non‑achat de denrées de piètre qualité, sans véritable intérêt nutritionnel. Les industriels utilisent souvent le prétexte du « plaisir » pour inciter à consommer, soutenus par des slogans tels que « Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas » ou « Mangez 5 fruits et légumes par jour », qui servent paradoxalement à booster les ventes de produits médiocres. Le Nutriscore, lui aussi, ne reflète pas toujours la qualité réelle des aliments.
Formule novatrice.
Ultramax Anti‑Oxydants est un complément naturel unique, dont les composés ont été soumis à des tests scientifiques rigoureux. Il accompagne les processus d’antioxydation, préserve l’organisme et redonne vitalité et bien‑être. Je vous invite à lire l’article "REDuire l’OXydation des cellules grâce à la naturopathie".
Ce complément aide l’organisme à se protéger du stress oxydatif, l’une des principales causes du vieillissement prématuré. Les radicaux libres, espèces chimiques instables, oxydent les cellules et fragilisent le système immunitaire, favorisant l’apparition de maladies comme le cancer. Seuls les antioxydants permettent de rétablir l’équilibre des fonctions naturelles de l’organisme. Grâce à sa formule unique en antioxydants végétaux, Ultramax Anti‑Oxydants agit comme un puissant anti‑âge, apportant bien‑être et vitalité.
Zinc.
Le zinc joue un rôle essentiel dans le processus de division cellulaire.
Spiruline.
La spiruline, algue à la valeur nutritionnelle exceptionnelle, est qualifiée de « super‑aliment ». Riche en vitamines C et E, en oligo‑éléments et en minéraux protecteurs, la spiruline issue de l’aquaculture biologique apporte un concentré d’antioxydants indispensables à l’organisme.
Thé vert.
Les feuilles de thé vert (Camellia sinensis) possèdent une action antioxydante remarquable. Grâce à leur teneur en polyphénols, elles participent à la prévention de certains cancers, de maladies cardiovasculaires et de l’élévation du taux de mauvais cholestérol.
Myrtille.
La myrtille est capable de piéger les radicaux libres qui dégradent l’ADN, contribuant ainsi à la protection cellulaire.
Les minéraux.
Les compléments alimentaires à base de minéraux comme le magnésium ou le potassium constituent des nutriments essentiels pour le système nerveux.
Magnésium.
Le magnésium est naturellement présent dans l’organisme. Il joue un rôle important dans le maintien du système nerveux. Les compléments alimentaires contenant du magnésium contribuent à la consolidation de l’activité cérébrale. Ils sont particulièrement utiles pour accompagner les troubles du sommeil ou du comportement. L’eau de Rozana est naturellement riche en magnésium.
Potassium.
Le potassium est l’un des minéraux incontournables de l’organisme. Il participe à la synthèse de certaines protéines et facilite le fonctionnement des glandes surrénales et des reins. Au niveau du système nerveux, il intervient dans la transmission et la diffusion de l’influx nerveux. Utilisé comme supplément alimentaire, il contribue à réduire l’apparition de troubles cognitifs.
Huile de CBD contre la douleur neuropathique.
Le CBD est un cannabinoïde extrait du chanvre, une plante de la famille du cannabis. Contrairement à la marijuana, le chanvre contient des quantités très faibles de THC, insuffisantes pour provoquer des effets psychotropes. Le CBD peut donc être utilisé en toute sécurité, même à des doses élevées.
Les cannabinoïdes agissent en interagissant avec le système endocannabinoïde du corps, récemment découvert, qui régule de nombreux processus physiologiques. L’intérêt pour l’huile de CBD ne cesse de croître, car elle apporte de nombreux bénéfices pour la santé et s’avère efficace pour soulager certaines affections, notamment la douleur neuropathique.
De nombreuses personnes utilisent l’huile de CBD pour réduire la douleur, en alternative ou en complément des analgésiques. Des études ont montré que le CBD soulage les douleurs modérées et chroniques, y compris les douleurs neuropathiques. Par exemple, une étude du European Journal of Pain a montré que le CBD appliqué sur la peau pouvait réduire la douleur et l’inflammation liées à l’arthrite. D’autres recherches ont mis en évidence son mécanisme d’action sur la douleur inflammatoire et neuropathique.
Même si les recherches sont encore récentes, les résultats sont prometteurs. De nombreux témoignages rapportent une amélioration de la gestion de la douleur chronique grâce au CBD. Il présente également d’autres qualités bénéfiques, comme son action anti‑inflammatoire naturelle et son rôle de neuro‑protecteur.
Pour bénéficier des meilleurs effets, il est essentiel de choisir une huile de CBD issue d’un fournisseur réputé, garantissant une transparence totale sur la culture du chanvre, les méthodes d’extraction et les analyses de laboratoire. Cela permet de s’assurer de la qualité et de l’efficacité du produit.
Le dosage du CBD varie selon plusieurs facteurs : poids, taille, âge, sexe et intensité des symptômes. Il n’existe pas de posologie unique. Par exemple, une douleur dorsale peut nécessiter un dosage différent d’une douleur articulaire. L’ajustement se fait en fonction de la réponse individuelle.
Le CBD apparaît donc comme un moyen efficace pour soulager divers types de douleurs et favoriser le bien‑être général. Il s’agit d’un complément prometteur, dont le potentiel thérapeutique reste encore à explorer.
Huiles essentielles et neuropathie.
Certaines huiles essentielles peuvent être utilisées en soutien pour atténuer les symptômes de la neuropathie. Voici deux recettes simples à préparer et à appliquer localement.
Recettes d’huiles essentielles.
Recette n°1 :
- 10 gouttes de Juniperberry.
- 10 gouttes de Géranium.
- 10 gouttes d’Hélichryse.
Recette n°2 :
- 15 gouttes de Géranium.
- 10 gouttes d’Hélichryse.
- 6 gouttes de Cyprès.
- 10 gouttes de Juniperberry.
- 5 gouttes de Menthe poivrée.
Mélanger la recette choisie avec une huile de support, comme l’huile de pépin de raisin ou l’huile d’amande douce, ou bien avec une lotion naturelle sans parfum de synthèse. Appliquer sur la zone concernée jusqu’à trois fois par jour.
Conclusion.
Bien que la neuropathie puisse être une affection chronique sans véritable remède, des douleurs nerveuses importantes peuvent révéler une cause sous‑jacente plus grave, comme une atteinte de la moelle épinière. Si les symptômes persistent ou s’aggravent, il est recommandé de consulter un professionnel de santé hygiéniste. Ces remèdes naturels, associés à des modifications du mode de vie, peuvent contribuer à soulager les symptômes et améliorer la qualité de vie.